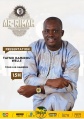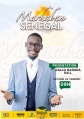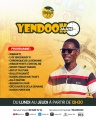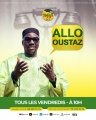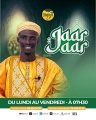Le soufisme est communément présenté comme la « mystique musulmane ». Cette expression a une certaine pertinence si on la comprend comme la connaissance des « mystères », comme une communion avec le divin par le biais de l'intuition et de la contemplation. Le Coran, qui distingue le « monde du Témoignage » ('âlam al-shahâda), c'est-à-dire le monde sensible, du « monde du Mystère » ('âlam al-ghayb), demande aux fidèles de croire en ce Mystère, le ghayb, littéralement « ce qui est absent de la vue ». L'un des buts du soufisme est précisément de percer l'opacité de ce monde, afin de contempler les réalités spirituelles dans un au-delà de la simple foi.
Pour René Guénon, le mystique est passif, alors que le soufi prend l'initiative de se plier à un « travail », pour se réaliser spirituellement. Le soufisme est donc, par essence, une voie initiatique, dans laquelle la relation de maître à disciple permet la transmission régulière de l'influx spirituel (baraka). Muni de cette protection, l'aspirant peut cheminer sur la voie afin de dépasser les limites de l'individualité, virtuellement ou effectivement, et d'atteindre la délivrance.
Du point de vue doctrinal, le soufisme est un courant ésotérique et initiatique, qui professe que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent et un aspect intérieur caché. Il se caractérise par la recherche d'un état spirituel qui permet d'accéder à cette connaissance cachée.
La première phase est donc celle du rejet de la conscience habituelle, celle des cinq sens, par la recherche d'un état d'« ivresse » spirituelle, parfois assimilé à tort à une sorte d'extase ; les soufis eux-mêmes parlent plutôt d'« extinction » (al-fana), c'est-à-dire l'extinction du moi pour parvenir à la conscience de la présence de l'action de Dieu. Cette première étape réalisée, le soufi doit revenir au monde extérieur qu'il avait dans un premier temps rejeté ; le lexique des soufis désigne cette phase par différents termes qui correspondent à autant d'aspects de ce second voyage : al-baqâ, la « subsistance ou la permanence », la lucidité (sahw), le retour (rujû') vers les créatures, semble-t-il.
Le postulant à l'initiation, qui est considéré comme étant à ce stade, est appelé mourîd (مُريد, novice; nouvel adepte; disciple). Vient ensuite le degré de l'âme qui se blâme elle-même, c'est-à-dire qui cherche à se corriger intérieurement, l'initié qui parvient à ce stade est appelé salîk ( سالك, voyageur) itinérant, allusion au symbolique « voyage intérieur ». Puis le troisième et dernier niveau est celui de l'âme apaisée.
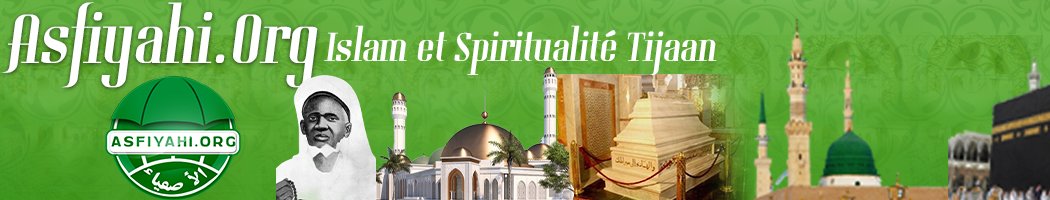
 Les Dernières nouvelles
Les Dernières nouvelles 

 definitions du soufisme
definitions du soufisme


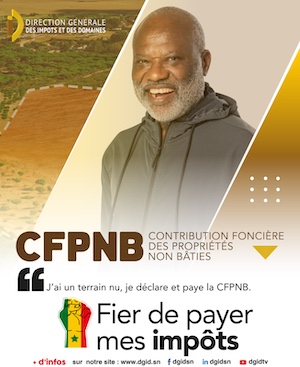
 L'ISLAM ET LA VIE SPIRITUELLE : LE SOUFISME
L'ISLAM ET LA VIE SPIRITUELLE : LE SOUFISME